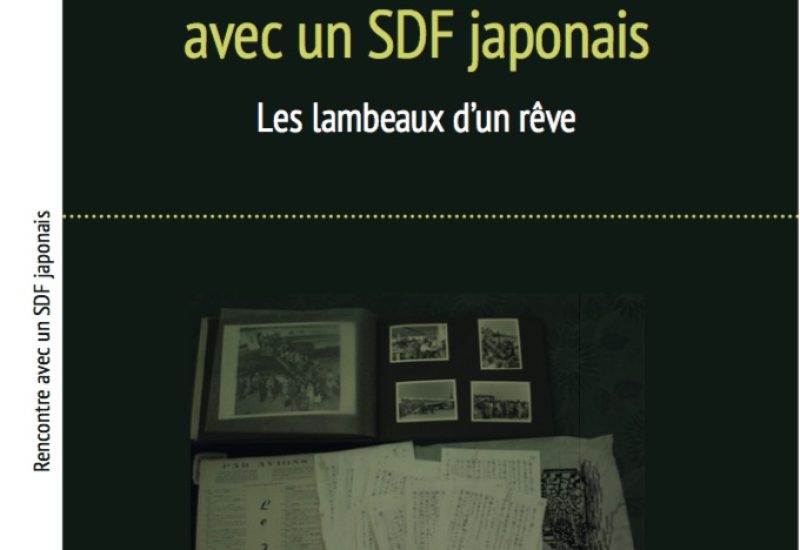ENQUÊTE Confronté à un déclin démographique sans précédent, le Japon a entrouvert ses frontières pour tenter de répondre aux besoins de main-d’oeuvre de ses entreprises. Mais la peur des étrangers empêche pour l’heure le pays de se lancer dans une véritable politique migratoire.
Par : Yann Rousseau (Les Échos 11 septembre 2018)
Il était temps de partir. Ses trois enfants grandissaient et les revenus de la famille ne suffisaient plus. En 2007, à l’âge de trente-sept ans, Grace a demandé un passeport pour la première fois à Manille et s’est embarquée pour Tokyo. Sa belle-soeur, déjà sur place, lui avait trouvé une famille française cherchant une nounou anglophone. Un emploi qui lui permettait d’obtenir l’un des rares visas de travail accordés, à l’époque, aux travailleurs étrangers par les autorités japonaises. « Mon salaire était alors de 180.000 yens [1.400 euros] par mois, c’est sept fois ce que je gagnais aux Philippines », se souvient-elle aujourd’hui. Au début, son mari et son fils aîné ont espéré la rejoindre, mais ils n’ont jamais pu obtenir le précieux sésame et ont abandonné l’idée.
Le gouvernement ne le reconnaîtra jamais, mais il a été obligé de lancer une politique migratoire
L’an dernier, sa nièce a profité d’un bouleversement de la politique nippone et a pu obtenir un visa de « stagiaire technique ” pour travailler pendant cinq ans maximum sur une ferme de Fukuoka, au sud du pays. « Les choses ont changé. Il y a maintenant plein d’entreprises qui demandent des étrangers », assure Grace. « Le gouvernement ne le reconnaîtra jamais, mais il a été obligé de lancer une politique migratoire “, confirme le professeur Atsushi Kondo, de la Meijo University, à Nagoya.
Fermé pendant des décennies à la main-d’oeuvre étrangère non qualifiée, le Japon multiplie désormais les initiatives pour recruter des travailleurs – de manière temporaire, assure Tokyo – dans le reste de l’Asie et en Amérique latine. Depuis 2012, le nombre d’actifs immigrés a augmenté de 600.000 dans l’Archipel pour atteindre, selon les statistiques gouvernementales, 1,3 million en fin d’année 2017. En seulement cinq années, la part des étrangers dans la population active nippone est ainsi passée de 1 % à 2 %. Et ce ratio va continuer de croître au fil du déclin démographique du pays.
Fonte de la population active
Alors que les baby-boomeurs qui avaient fait bondir la croissance japonaise dans la seconde moitié du XXe siècle partent en masse en retraite depuis 2010 et que le faible taux de natalité ne permet plus de les remplacer, le pays doit encaisser un effritement accéléré de sa population active alors que la croissance reste soutenue. Déjà décimés, les rangs des 15-64 ans vont encore fondre de… 15 millions d’individus d’ici à 2040.
Pour compenser ces départs, le gouvernement repousse l’âge de la retraite et encourage, avec un certain succès, le retour vers l’emploi de personnes sorties des statistiques. Des centaines de milliers de femmes, anciennement « au foyer », ont ainsi repris des contrats à temps partiel depuis 2013. Des grands-pères de plus de 70 ans continuent de conduire leurs taxis la nuit à Shinjuku. Et les restaurants ont facilité les petits jobs pour les étudiants. Mais ces artifices ne suffisent pas.
Mesuré à 2,2 %, le chômage est tombé à son plus bas niveau des vingt-cinq dernières années. Et à chaque centaine de demandeurs d’emplois correspondent désormais 160 offres de poste. Du jamais-vu. « On ne s’en sort plus, soupire le patron d’une société de commerce en ligne. Informaticiens, secrétaires, livreurs… On ne trouve plus personne. »
Lobbying des entreprises
Sur les chantiers des Jeux Olympiques de Tôkyô les géants du bâtiment sont inquiets. Un tiers des ouvriers dans le secteur de la construction a plus de 55 ans. Les moins de 30 ans ne représentent que 11 % de leurs effectifs. Dans les maisons de retraite, où arrivent de plus en plus d’anciens, 40.000 postes sont déjà vacants. Selon les projections du ministère de l’Economie, ce sont… 790.000 personnels qui manqueront en 2035.
A la même période, des milliers de fermes auront fermé, faute de paysans. Leur moyenne d’âge atteint déjà 67 ans. « Les grandes entreprises et les fédérations professionnelles ont tiré l’alarme. Elles exigent des solutions du gouvernement “, résume Atsushi Kondo. « La Chambre de commerce et d’industrie du Japon qui regroupe les PME est particulièrement virulente et a activé son lobbying auprès du parti majoritaire, le LDP “, confirme Daniel Kremers, un spécialiste des questions d’immigration au German Institute of Japanese Studies de Tokyo.
Sous pression, le gouvernement de Shinzô Abe a dû accepter d’ouvrir progressivement ses frontières. Il a d’abord élargi le programme des « stagiaires techniques “. Initialement lancée, sur un périmètre réduit, dans les années 1990, cette politique se propose d’accueillir, pour un maximum de cinq ans, des jeunes travailleurs venus d’Asie du Sud-Est afin d’officiellement leur « offrir » une formation technique, utile plus tard au développement de leur propre pays.
Avec cette excuse de la « coopération internationale “, Tokyo a pu venir en aide aux secteurs de la construction, de l’agriculture et à des centaines d’usines dans les secteurs du textile, de l’agroalimentaire ou de l’automobile. Nissan ou encore Mitsubishi ont ainsi utilisé ce réseau pour compléter leurs chaînes d’assemblage. Actuellement, 260.000 personnes, essentiellement venues du Vietnam, de Chine, des Philippines ou encore d’Indonésie travaillent sous ce statut.
« Aide au retour vers la patrie “
Pour combler les pénuries de main-d’oeuvre dans les restaurants et les magasins, qui ne peuvent légalement pas accueillir de « stagiaires », l’exécutif a aussi favorisé l’emploi d’étudiants étrangers. Leur visa leur donnant désormais le droit de travailler au maximum 28 heures par semaine. Ils touchent le salaire minimum : 880 yens de l’heure, soit 7 euros.
A Osaka, les comptoirs des konbinis, les supérettes ouvertes 24 heures sur 24, sont de plus en plus tenus par des Birmans, des Népalais ou des Chinois, qui se doivent de parler en japonais pour ne pas traumatiser les clients. Dans les 17.200 supérettes FamilyMart de l’Archipel, plus de 5 % des caissiers sont maintenant des étrangers.
Chez Tokoya, un coiffeur de la gare d’Otsuka, le patron a, lui, profité des nouvelles facilités faites aux descendants de Japonais partis s’installer à l’étranger avant la Seconde Guerre mondiale. Il a ainsi embauché deux « nikkeiji » – « gens d’origine japonaise » – venus du Pérou. Joaquin a débuté en mars, dans le salon où travaillait déjà son oncle, après avoir pu prouver qu’il avait eu un grand-père japonais.
Lancé dans les années 1990, ce programme, présenté comme « une aide au retour vers la patrie ” par Tokyo pour dissimuler ses objectifs économiques, a attiré, au fil des ans, plus de 470.000 personnes, venues essentiellement du Brésil et du Pérou. Et le gouvernement de Shinzo Abe vient d’assouplir ce programme, en juillet, pour faciliter l’emploi des descendants de quatrième génération ayant vécu au Japon avec leurs parents.
Variables d’ajustement
Le ministère de l’Economie n’a toutefois que des attentes limitées pour ce nouvel assouplissement. Les « nikkeiji ” se souviennent qu’ils avaient été incités à repartir après la crise financière de 2007 et l’envolée des licenciements. Tokyo avait même offert des billets d’avion aux volontaires au départ pour alléger la pression sur ses propres systèmes de protection sociale.
Une absence de solidarité qui avait écoeuré beaucoup des « descendants » et avait relancé le débat sur l’hypocrisie de la stratégie japonaise. « Le Japon ne peut pas survivre sans travailleurs étrangers, mais il ne veut pas l’admettre et ne fait donc rien pour eux », s’agace Ippei Torii, un activiste à la tête du Réseau de solidarité pour les migrants du Japon (SNMJ).
Tokyo ne traite les travailleurs étrangers que comme des variables d’ajustements temporaires à ses problèmes de main-d’oeuvre et refuse absolument de présenter ces différents programmes comme de l’immigration. « Nous ne faisons pas une politique migratoire », a encore martelé, cet été, le Premier ministre, Shinzo Abe, après avoir présenté un nouvel assouplissement qui devrait, cette fois, permettre d’attirer 500.000 travailleurs étrangers supplémentaires d’ici à 2025 sur des visas de quelques années.
« Une politique d’immigration, ce serait une politique qui accepterait des étrangers sans fixer de limite de temps à leur séjour. Le Japon n’adoptera pas ce genre de solution “, a asséné le chef du gouvernement, qui ne veut pas effrayer son électorat très conservateur.
Crainte et refus de l’intégration
A droite, comme à gauche, le mot « imin ” – « immigré » – reste ainsi banni des discours. Trop sensible. « Les politiciens entretiennent l’idée que le peuple japonais serait mono-ethnique et qu’il faut préserver cette homogénéité. Mais c’est une illusion », s’agace Ippei Torii, qui rappelle les habituels discours japonais sur les risques sociaux liés à l’immigration.
Pointant des exemples occidentaux, les commentateurs s’inquiètent d’une éventuelle poussée de la délinquance, d’une ruine des services sociaux, dont les étrangers voudraient abuser, ou même de l’apparition d’un terrorisme islamiste. « Les élites évoquent souvent l’arrivée massive de travailleurs turcs en Allemagne pour expliquer que les politiques migratoires se soldent par des échecs “, précise Daniel Kremers.
Le problème, c’est que les travailleurs ne sont pas protégés par le système
Enfermé dans cette logique, Tokyo n’a dessiné aucune politique d’intégration qui suggérerait que ces travailleurs pourraient être amenés à rester dans le pays à vie. « Le problème, c’est que les travailleurs ne sont dès lors pas protégés par le système. Il y a de nombreux abus », détaille le président du SNMJ. Chaque mois, dans ses locaux près du parc d’Ueno, il reçoit des jeunes étrangers maltraités par leurs employeurs japonais.
Abus et scandales
« Leur visa ne les autorise à travailler que pour une seule entreprise pendant toute la durée de leur séjour. S’ils cherchent à changer, c’est l’expulsion. Les patrons peuvent donc tout leur imposer. “ Des heures supplémentaires non rémunérées, de mauvais traitements, d’énormes retenues sur salaire pour payer leur dortoir ou leur repas. « Ces jeunes sont très endettés car ils doivent rembourser, dans leur pays, les sommes exigées par l’agent qui leur a trouvé une place au Japon “, explique l’activiste. Le ticket d’entrée se négocierait en ce moment à 7.500 euros aux Philippines. Et le gouvernement japonais n’a que peu de moyens pour contrôler ces abus.
Début 2018, plusieurs scandales ont réveillé l’opinion publique. Un sous-traitant du chantier de démantèlement de Fukushima a employé des stagiaires vietnamiens près des réacteurs détruits. Ailleurs, ce sont les salaires trop faibles qui sont dénoncés. Et les jeunes réalisent que d’autres pays asiatiques touchés par un effondrement de leur natalité, tels que la Corée du Sud, commencent à offrir de meilleures paies ou des statuts plus protecteurs.
Yuriko vise, elle, l’Australie. « J’en ai marre maintenant “, souffle la jeune employée d’une boutique de téléphonie mobile. Elle est née, il y a vingt et un ans, à Saitama, juste au nord de Tokyo dans une famille de « nikkeijin » péruviens. Elle n’est jamais allée au Pérou et a suivi toute sa scolarité ici. Un japonais parfait. L’uniforme bleu marine impeccable des employées. Mais, officiellement, elle reste une étrangère. Elle se fait parfois contrôler par la police. « Quand j’étais étudiante, les restaurants me refusaient des petits boulots. Je n’avais pas la bonne couleur de peau et ils me le disaient. » Elle vient d’entamer le parcours du combattant pour obtenir la nationalité nippone. « Si j’obtiens le passeport, je m’en vais. Probablement pour toujours. “